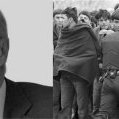Extraits
Au fil des mois, à longueur de journaux télévisés, dans les dîners en ville comme dans les meetings, la Chine, l’Inde ou la Commission européenne sont devenues nos boucs émissaires. Nous expions sur eux nos malaises, tout en nous exonérant d’une réflexion sur leur cause réelle. Car celle-ci est, je le pense, moins conjoncturelle et plus profonde. L’Europe est fatiguée. Non pas « vieille » comme l’a prétendu Donald Rumsfeld. Mais fatiguée d’une génération au Pouvoir qui a fredonné depuis trente ans la chanson d’un Progrès porté, tantôt par des projets politiques, tantôt par le primat de l’économie.
Mais voilà, relisons le siècle dernier ! En Europe, c’est la politique qui a charrié la barbarie. C’est par la voix démocratique que s’est construit le nazisme qui s’est ingénié à détruire jusqu’au souvenir des hommes. C’est encore la politique qui a permis la naissance et l’utilisation de l’arme atomique, mettant en danger, et pour longtemps, non seulement les cités, les ressources ou les créations de l’homme, mais l’espèce humaine elle-même. Dès le milieu du 20e siècle, comme le souligne Hannah Arendt, la politique « mal nécessaire à la conservation de l’humanité, a alors effectivement commencé à disparaître du monde, c’est-à-dire que son sens a viré en absence de sens » [1]. Et c’est encore au nom d’idéaux politiques monstrueux qu’ont été effacées des dizaines de millions de vies en URSS, en Chine ou au Cambodge.
Sur ce fond séculaire de mort se détache avec peine l’ombre de quelques hommes qui, au nom de la liberté, ont évité à l’Europe de basculer dans l’abîme. Mais on n’a sans doute pas assez souligné que c’est par l’économie et non par la politique que ces mêmes hommes ont choisi d’entamer le rapprochement des peuples et la construction d’une identité européenne. Comme si, dès le milieu du siècle, on admettait que la liberté n’était plus consubstantielle à l’idée même de politique mais serait désormais portée par l’économie : dès lors, elle allait tirer profit de cette confusion pour parer de toutes les vertus ce qu’on appellerait naturellement « libéralisme »...
Les Trente Glorieuses ont entériné le déclin progressif du politique au profit de l’économique. Le progrès scientifique et ses développements techniques, en permettant l’abolition des distances, en affranchissant des frontières la circulation des idées, des flux financiers, des flux d’information et des hommes, a laissé les Etats désemparés, contraints à s’adapter et à s’aligner sur une économie qu’auparavant ils contrôlaient. Très symboliquement, la chute du mur de Berlin, manifestation de l’implosion du système soviétique, a parachevé le triomphe d’un système économique unique.
Les années 90 ont été présentées comme le début de la fin de l’Histoire et de la disparition des Etatsnations, devenus au mieux inutiles, au pire des obstacles à une mondialisation qui, nous disait-on alors, allait générer la paix et la prospérité pour tous. L’universitaire Pascal Salin dévoila quelques années plus tard l’obsession de ces années : « la mondialisation, si elle contribuait effectivement à la destruction des Etats-Nations, serait un bienfait pour l’humanité » [2]. La « nouvelle économie », fondée sur la virtualité, renvoyait l’industrie, ses cols bleus et ses gueules noires aux archives de l’histoire, et allait transformer le monde en le rétrécissant, en rapprochant les hommes et en créant, par génération spontanée, une activité économique porteuse de croissance. Les bourses du monde entier y croiront le temps que se bâtissent quelques fortunes immenses jusqu’à l’absurde et l’éclatement en 2000 de la « bulle Internet ».
Mais pas plus que la politique, l’économie n’a apporté la paix et la prospérité pour tous. Les zones de conflits se sont multipliées dans le monde, ceux qui avaient de l’argent l’ont valorisé, ceux qui n’en avaient pas en ont moins encore : on meurt autant de faim ou d’épidémies sous le règne d’une économie mondialisée. Ce constat de double échec suffirait déjà à expliquer, au moins en partie, la perte de confiance des citoyens dans leurs représentants et leur refus d’un système économique qui met souvent leur quotidien en danger.
Si nous n’y prenons garde, le pire est à venir : ce serait la mondialisation de la confusion des genres, la collusion générale entre politique et économie. A l’aube de ce siècle, le 27 janvier 2000, le Président des Etats-Unis, William Jefferson Clinton nous en a donné le principe dans un discours de politique générale devant le Congrès [3]. La fusion entre politique et économie était au cœur du discours présidentiel qui fixait à l’Amérique une mission : « Ce n’est ni un problème démocrate ni un problème républicain. C’est un problème américain. Pour réaliser les entières possibilités de la nouvelle économie, nous devons dépasser nos propres frontières, mettre en forme la révolution qui abat les obstacles et installe de nouveaux réseaux parmi les nations et les individus : la mondialisation. C’est la réalité centrale de notre époque. [...] Nous devons être au centre de tout réseau mondial vital, comme bon voisin et partenaire. Nous ne pouvons pas construire notre avenir sans aider les autres à construire le leur [4]. Le titre sous lequel fut publié ce discours, »Shaping the world « , reflétait parfaitement l’inconscient d’une Amérique démiurge, soucieuse de façonner une humanité » à son image et à sa ressemblance".
Si j’ai choisi d’écrire ce livre, c’est parce que je suis convaincu qu’érigée en modèle de gouvernement, la collusion des intérêts politiques et économiques conduit l’humanité au chaos. Mon objectif est de convaincre les incrédules que nous ne sommes pas sous le règne d’une « concurrence libre et non faussée ». Cette idée, prônée à longueur de médias par quelques aveugles exaltés, est absurde. Seule une prise de conscience politique encadrant un développement économique européen est susceptible d’éviter de graves désordres, d’ores et déjà prévisibles. Ces pages présentent les acteurs des mutations du monde, leurs jeux et la subtilité de leurs règles, quelques propositions pour en corriger les effets destructeurs, et tendre vers la « paix économique ». Je les dédie aux hommes et aux femmes qui ne croient plus en la politique. J’invite à l’indulgence ceux qui me reprocheront un ton qui frise parfois la révolte, voire la colère. Il est urgent d’agir. Et c’est à nous, politiques - et particulièrement politiques européens -, de reprendre en main notre destin. Ce siècle sera politique ou ne s’achèvera pas.
Bernard Carayon, 48 ans, avocat, est député (UMP) du Tarn et Maire de Lavaur. Rapporteur du budget de l’Industrie, puis du renseignement à la Commission des Finances de l’Assemblée nationale, il construit dans ses rapports parlementaires et ses publications ( www.bcarayon-ie.com) une politique publique d’« intelligence économique », dont il est devenu en France le spécialiste incontesté. Promoteur du « patriotisme économique », il est président de la Fondation d’entreprises Prometheus, dédiée à l’analyse des enjeux de la mondialisation, qu’il a créée avec le concours de dix des plus grands groupes industriels, financiers et bancaires, français et européens.
Source : : http://www.larevueparlementaire.fr/...